2024 en bref
01Grandes lignes
Bien qu’annoncée comme l’année la plus chaude en Europe depuis 1850, 2024 aura été clémente pour les bâtiments du canton, particulièrement en ce qui concerne les dommages naturels. Après le déchaînement du 24 juillet 2023, dont les conséquences se sont encore alourdies, les quelques épisodes météorologiques marquants de l’exercice écoulé ont paru bien anodins. Ce relatif répit a été le bienvenu, le traitement des dossiers de La Chaux-de-Fonds ayant continué de mobiliser une part importante des ressources de l’Etablissement, mais également de la disponibilité des artisans.
Heureusement, une fois de plus, le système mis en place par les établissements cantonaux d’assurance (ECA) de Suisse a fait ses preuves. Au-delà des couvertures de réassurance classiques contractées au travers de l’Union intercantonale de réassurance, le mécanisme de solidarité entre ECA a parfaitement fonctionné. C’est ainsi que plus de la moitié des dommages de 2023 ont été pris en charge par les établissements des autres cantons. L’ECAP ne peut qu’être reconnaissant de ce soutien, à plus forte raison puisque c’est la seconde fois qu’il y recourt, après 2021.
Sur le plan interne, 2024 peut être considéré comme une année de consolidation.
Pour le secteur Assurance, l’année aura été marquée par le passage d’une gestion de crise à une organisation renforcée, mais agile. Le défi consiste à pouvoir s’adapter à des variations extrêmes de l’activité en étant capable de traiter un volume important de sinistres, impliquant des milliers de devis et de factures. Parallèlement il s’agit de garantir une charge de travail suffisante dans les périodes creuses. La polyvalence des collaborateurs, entre sinistres et estimations, permet d’atteindre cet objectif.
Une certaine stabilisation est également en vue au sein du secteur Prévention. Après le lancement de la campagne contre le ruissellement en 2023, ses effets se sont déployés au fil des mois. Le flux soutenu des demandes de subvention et des réalisations de mesures de protection s’est confirmé, attestant de la pertinence de l’action. La réforme du fonctionnement des commissions de police du feu, par la digitalisation des visites et de la formation, s’est poursuivie, laissant augurer une mise en œuvre complète en 2025.
Le secteur Intervention a vu son activité fortement influencée par l’avancement du chantier de la piste de formation de la Presta. Outre la gestion des travaux, les plans de formation ont dû être adaptés aux nouvelles infrastructures afin d’exploiter au mieux l’outil à disposition. La fin des travaux est planifiée vers la mi-2025 avec une inauguration officielle fixée au 12 septembre.
La transformation des différents environnements au sein desquels évolue l’ECAP a incité son conseil d’administration et sa direction à lancer une réflexion approfondie sur le développement de l’institution. Quatre axes principaux qui orienteront les efforts et les actions dans les années à venir ont été définis, à savoir :
- l’amélioration de la résilience des bâtiments,
- les moyens d’intervention des collectivités
lors d’événements naturels de grande
ampleur, - la capacité de l’ECAP à traiter des sinistres
de masse, - l’évolution de l’organisation et de la culture
de l’établissement face aux changements
sociétaux.
Ces lignes directrices vont guider les politiques de l’ECAP durant les prochains exercices afin de lui permettre d’être armé pour assumer ses responsabilités à l’égard des propriétaires neuchâtelois.
Au final, une sinistralité modérée et de bons rendements financiers permettent de clôturer l’exercice 2024 sur un bénéfice réjouissant qui permet de compenser la perte historique de 2023.
Cet exercice clôt une période de 12 ans de présidence à la Chambre d’assurance immobilière pour le soussigné de gauche, période durant laquelle, l’ECAP aura su se renforcer, se consolider financièrement et se moderniser, dans un contexte historiquement inédit. Au travers d’une succession d’événements de grande ampleur l’établissement a adapté son organisation et consolidé ses bases pour affronter les mutations de l’environnement, confirmant ainsi son rôle au côté des propriétaires neuchâtelois pour prévenir, intervenir et assurer.
Alain Ribaux
Président de la Chambre d’assurance immobilière
Jean-Michel Brunner
Directeur de l’ECAP

Chiffres-clés
2024
2023
Assurance
02
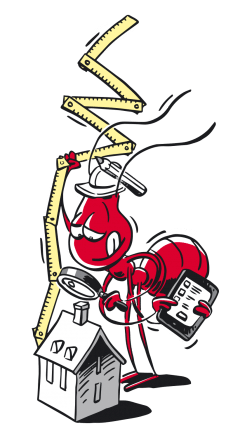
L’année a été très chargée tant pour le personnel technique qu’administratif. Ce sont plus de 8’000 devis et 5’900 factures en lien avec la tempête du 24 juillet 2023 qui ont été analysés, amendés et/ou validés. À cela s’ajoute bien évidemment la gestion des sinistres courants et le solde des événement de 2021 (grêle, hautes eaux et laves torrentielles). Fort heureusement, grâce à une bonne collaboration tant avec les artisans qu’avec les propriétaires ou leurs représentants, le traitement des cas même complexes a pu avancer de façon très satisfaisante.
Patrimoine bâti
Après une indexation partielle des valeurs d’assurance en fonction de l’évolution des coûts de la construction en 2023, un nouvel ajustement de 5.65% a été nécessaire en 2024. Cette hausse se reflète dans l’accroissement de la valeur du patrimoine bâti neuchâtelois. Au 31 décembre 2024, les capitaux assurés se montaient à 66.07 milliards de francs en augmentation de 6.04% par rapport à l’année précédente. Le nombre de bâtiments a, pour sa part, progressé de 0.70% pour atteindre 51’965.
Types de construction et usages
Les bâtiments voués à l’habitation représentent toujours près des deux tiers (65.86%) de la valeur du patrimoine bâti cantonal et 55.28% du nombre total de bâtiments. C’est au Val-de-Ruz que cette proportion est la plus forte, respectivement 71.51% de la valeur et 55.25% des bâtiments. À l’inverse, au Val-de-Travers, ces proportions sont de 62.04% et 46.45%.
En variation annuelle et abstraction faite de l’effet de l’indexation, c’est la valeur des bâtiments de la catégorie « Trafic et transport » qui a le plus augmenté (+1.83%) ainsi que celle des bâtiments à usage commercial (+1.66%). Au contraire, les bâtiments destinés à l’hébergement et la restauration et ceux à vocation agricole ont vu leur valeur d’assurance totale décroître, respectivement de 1.44% et 0.20%.
Valeurs d’assurance
Conformément au principe des établissements cantonaux d’assurance, les bâtiments du canton sont assurés en valeur à neuf, sauf dans des cas particuliers, notamment lorsque le bâtiment est fortement déprécié de manière globale ou pour certains de ses éléments.
Sur l’ensemble du canton, les bâtiments assurés en valeur à neuf, sans restrictions, représentent 88.73% du capital assuré. Cette part varie toutefois quelque peu selon les régions. Sur le Littoral et au Val-de-Ruz, elle est supérieure à 90%, respectivement 90.58% et 91.79%, alors qu’elle avoisine 85% dans les Montagnes et au Val-de-Travers (85.82% et 84.55%). A l’inverse, la part des assurances provisoires, pour des bâtiments en construction ou en transformations importantes, est plus faible sur le Littoral et au Val-de-Ruz (1.61% et 1.68%) qu’au Val-de-Travers (1.85%) et surtout dans la région des Montagnes (2.23%).
Estimations
La forte sinistralité enregistrée entre 2019 et 2023 a continué de perturber le rythme décennal des estimations. Si en 2023, les estimations réalisées par les experts externes et internes n’avaient pas atteint les 2800 visites, en 2024, 3849 bâtiments ont été estimés ou réestimés. Ce résultat, en sensible amélioration, s’explique par deux facteurs principaux, d’une part la diminution progressive du nombre de sinistres ouverts, mais aussi et surtout, la décision d’augmenter le nombre d’experts externes mandatés par l’ECAP. Avec une trentaine de professionnels qualifiés, dont une dizaine en formation, ce collège offre à l’établissement une flexibilité indispensable en cas d’événements de masse. En effet, une partie d’entre eux ont suivi une formation spécifique pour traiter des sinistres, en particulier dus aux éléments naturels, et, si nécessaire, ils peuvent être appelés, en fonction de leur disponibilité, à compenser les estimations que les experts internes ne peuvent pas effectuer en raison de leur charge de travail.
Primes
En l’absence de modification de tarif, les primes ont évolué en fonction de l’augmentation du capital assuré. Celle-ci se compose de trois facteurs :
- l’indexation des valeurs en fonction du coût de la construction,
- la réestimation périodique,
- les nouvelles constructions et les transformations.
La combinaison de ces différents éléments a pour effet une hausse des encaissements de 5.5% pour les primes d’assurance (5.93% y compris la contribution pour la prévention et la défense).
Malgré ces hausses, une comparaison effectuée en 2024 avec les primes pratiquées par les assureurs privés dans un canton sans ECA montre que l’ECAP reste environ 25% moins cher, malgré un investissement beaucoup plus conséquent dans les secteurs de la prévention et de l’intervention.
Indice
Afin de suivre l’indice Mittelland de l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’indice ECAP a passé de 124 à 131, soit une augmentation de 5.65%. Celle-ci s’ajoute à l’adaptation opérée en 2023. Avec ces deux ajustements successifs, les valeurs d’assurance suivent assez fidèlement l’indice calculé par l’OFS qui constitue la référence légale. La décision de ne pas répercuter complètement la hausse de l’indice s’est basée sur la tendance constatée du tassement de certains coûts, notamment ceux de la rénovation. Le maintien de la valeur d’assurance au plus près des coûts qu’engendrerait la reconstruction totale d’un bâtiment sinistré reste une condition essentielle pour prévenir toute situation de sous-couverture.
Sinistres
Après les records de sinistralité enregistrés en 2021 et 2023, le calme de l’exercice 2024 a été le bienvenu, tant sur le plan financier que pour les collaborateurs de l’ECAP dont le volume de travail demeure très élevé. Au 31 décembre, 3453 sinistres restaient en traitement dont 93% liés à des éléments naturels.
En volume d’indemnités, l’exercice 2024 se situe environ à la moitié de la moyenne historique sur 20 ans qui sert de base budgétaire pour les dommages annuels. Les sinistres dus aux incendie ont provoqué pour 5.17 millions de francs de dommages et ceux dus aux éléments naturels pour 3.58 millions de francs, soit un total de 8.74 millions, bien en-deçà des 16 millions budgétés.
Dommages incendies
Avec 222 cas reconnus, le nombre d’incendies se situe dans la moyenne des 10 dernières années. Fort heureusement, les dommages causés sont en baisse de 23% par rapport à cette même moyenne.
Le principal sinistre de l’année à La Chaux-de-Fonds représente à lui seul 37% des dommages annuels. Les autres sinistres conséquents, dépassant les 100’000 francs d’indemnités, sont au nombre de 6 pour un total d’indemnités de 1’370’000 francs.
NB : Moins de douze mois après les sinistres, les causes non élucidées représentent encore un fort pourcentage des dommages. Cela est en partie lié à la durée des enquêtes de police pour établir l’origine exacte d’un incendie. En nombre de cas, seuls 9% d’entre eux ont des causes qui restent indéterminées.
Dans ce cadre, l’ECAP a renouvelé au mois de décembre la convention qui lie les quatre ECA romands à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne. Les ECA financent ainsi un demi-poste de doctorant et un poste d’expert/spécialiste dans son centre d’investigation en incendies. Cette collaboration permet un renforcement des connaissances en matière de déclenchement et de développement de sinistres ainsi qu’un appui accru aux polices cantonales pour la détermination des causes de sinistres ainsi que la formation initiale et continue de leurs collaborateurs.
Les actions de recours menées à l’encontre de tiers responsables d’incendies, ou de leurs assurances, ont permis d’encaisser plus de 300’000 francs, réduisant d’autant les charges de l’ECAP, notamment grâce à l’accord passé avec les assureurs privés au travers de l’Association Suisse d’Assurance qui régit depuis 2015 la majorité des cas de recours.
Dommages éléments naturels
Malgré quelques épisodes relativement violents, l’année n’aura connu aucun événement pouvant être qualifié de catastrophique. Avec 608 sinistres, 2024 se situe parmi les années relativement agitées, en l’absence de sinistres de masse. Seules les pluies torrentielles du 18 août, avec 121 sinistres annoncés et près de 900’000 francs de dommages auront vraiment marqué les esprits. Néanmoins, divers petits épisodes ont émaillé l’année, notamment des coups de vents, des pluies violentes et pour la première fois depuis plusieurs années des chutes de neige importantes au mois de novembre.
Tempête du 24 juillet 2023 à la Chaux-de-Fonds
Tant les travaux de déconstruction réalisés par différents corps de métier que les aléas météorologiques ont mis en évidence, dans le courant de l’année 2024, des dégâts non détectables a priori. Ces constats ont conduit à une augmentation des provisions pour les sinistres liés à l’événement. Le nombre de sinistres reconnus en lien avec la tempête se monte désormais à 3041, pour une somme de dommages qui pourrait dépasser les 136 millions de francs. Cela représente près de 8’000 devis analysés et plus de 5’700 factures réglées.
Au 31 décembre 2024, 946 sinistres sont clos pour un total d’indemnités de 14.1 millions de francs et 2095 cas sont encore en cours représentant d’ores et déjà 69.6 millions de francs de versements aux propriétaires sinistrés.
Réassurance
Conformément aux mécanismes mis en place au niveau des instances nationales des ECA, l’ECAP a eu recours tant aux prestations de réassurance qu’à la solidarité intercantonale pour couvrir les indemnités découlant des sinistres de 2023 dus aux éléments naturels.
C’est ainsi qu’à partir du mois d’août 2024, les prestations maximales contractuelles de la réassurance ont été atteintes et que ce sont les ECA des autres cantons qui ont contribué à la couverture des indemnités versées aux assurés neuchâtelois.
En décembre 2024, l’Union intercantonale de réassurance a informé les directions des ECA des résultats des études relatives au potentiel maximal de dommage pouvant être atteint pour différents temps de retour. Ces études sont réalisées périodiquement afin de permettre de dimensionner au mieux les couvertures de réassurance et la capacité de la Communauté intercantonale de risque éléments naturels (CIREN). Ces résultats, basés à la fois sur la sinistralité passée et les projections futures, font ressortir un potentiel de dommages en forte augmentation par rapport à 2020. À un horizon de 100 ans, le montant maximum des dommages dus aux éléments naturels, en une année, a passé de 104 millions à 148 millions de francs. Ces chiffres, disponibles pour chaque ECA, serviront de base à des réflexions sur la capacité maximale de la CIREN, aujourd’hui fixée à 1.6 milliards de francs.

Prévention
03

Les principaux projets en cours ont été poursuivis en 2024 dans le secteur de la Prévention. Il s’agit principalement de la finalisation de l’outil ECAPrev et de la mise en place d’un programme de formation hybride, tous deux en faveur des commissions communales de police du feu. La réalisation des tests et la mise en exploitation des derniers développements du nouveau logiciel PEGGI ont également constitué un pan important de l’activité, impactant le temps à disposition pour les activités courantes du secteur.
Communes
Commissions de police du feu
Au vu de l’évolution des exigences en matière de contrôles et de visites périodiques des bâtiments, l’ECAP continue de s’investir fortement pour apporter un soutien aux communes. Comme ces dernières années, l’appui se concentre sur 3 volets :
- L’amélioration du contrôle périodique des bâtiments par la formalisation des visites et des rapports.
- La formation des commissaires pour adapter les compétences aux spécificités des bâtiments à contrôler.
- Une aide ou des réponses à des questions lors de visites de bâtiments complexes ou particuliers.
Afin de faire le point sur ces différentes activités de l’année, ainsi que sur plusieurs dossiers en lien avec la prévention, les assemblées annuelles des commissions de police du feu se sont déroulées au mois de mars dans les locaux de l’ECAP à EspaceVal à Couvet. La première session, à l’intention des représentants des Montagnes et des 2 Vallées, s’est déroulée le 21 mars en présence de 79 participants. La seconde destinée aux communes du Littoral a eu lieu le 26 mars et a réuni 80 personnes. Outre une brève rétrospective de l’activité de l’année écoulée, trois sujets principaux ont occupé les participants, l’avancement de la plateforme ECAPrev, les tests des systèmes de désenfumage et une présentation des activités de Vadec, sous l’angle de la prévention incendie et des dangers liés aux batteries au lithium.
Subventions
La Chambre immobilière d’assurance a entériné en août 2024 quelques modifications du règlement de subventions visant à élargir et préciser les mesures susceptibles de faire l’objet d’un soutien de l’ECAP. Ces mesures peuvent être regroupées en trois catégories, à savoir :
- L’aménagement de voies de fuite
L’objectif est de pouvoir subventionner des mesures qui, bien que réalisées dans le cadre d’un permis de construire, sont prises volontairement par le propriétaire et ne sont pas motivées par une exigence de l’autorité. - La protection contre les incendies de batteries
Au vu de la recrudescence d’incendies liés à des batteries rechargeables ou des accumulateurs, et en soutien de la campagne des ECA romands, l’acquisition d’armoires coupe-feu reconnues pour le stockage ou/et la charge de batteries dans les bâtiments sera soutenue. - Les sondes à fourrage
L’évolution de la technologie des sondes à fourrage permet, à des coûts compétitifs, d’assurer un suivi de la température du foin et de recevoir des alertes lorsque celle-ci atteint un niveau critique. La subvention se monte à 50% du coût du dispositif.
Dossiers de subventions
Le nombre de demandes de subventions reçues en 2024 a augmenté de 25%. Si les dossiers relatifs à des mesures de protection contre l’incendie ont été stables, celles en lien avec les éléments naturels ont crû fortement (253 contre 152 en 2023), très majoritairement en raison du succès de la campagne « Pas dans ma maison ».
Les versements effectués en 2024 se montent à 931’500 francs et ont concerné 289 dossiers.
Actions spéciales
Campagne de prévention « Pas dans ma maison »
En 2023, l’ECAP lançait une vaste campagne visant à réduire les dommages aux bâtiments dus aux eaux de ruissellement. Pour mémoire, cette action d’une durée de 5 ans et dotée de 4 millions de francs consiste à accorder un subventionnement doublé de toute mesure de protection d’un bâtiment figurant dans une zone menacée, selon la cartographie fédérale.
Après un peu plus d’une année et demi, l’intérêt des propriétaires se confirme et le nombre de demandes augmente régulièrement. Au 31 décembre 2024, plus de 360 dossiers avaient été ouverts dans le cadre de la campagne. Conformément aux prévisions initiales, la plupart des cas peuvent être résolus par des mesures simples et souvent peu coûteuses.
L’offre d’un diagnostic initial sommaire par un bureau d’ingénieurs civils, entièrement pris en charge par l’ECAP, est une mesure très populaire dont 200 assurés ont déjà bénéficié. Il est ainsi possible de savoir si une étude plus détaillée est requise et planifier efficacement les réalisations nécessaires.
À ce jour, 301 dossiers de subventions ont été traités et clôturés pour un montant de 244’000 francs.
Campagne romande « Lithium »
Après avoir collaboré durant plusieurs années à la réalisation d’une action commune de prévention des dommages dus aux orages intitulée « Avant la tempête », les 4 ECA romands ont poursuivi leur collaboration en 2024. Ils ont lancé une nouvelle campagne dédiée aux risques d’incendie liés aux batteries Lithium-Ion. Diffusée via les médias traditionnels, en programmatique et relayée par les réseaux sociaux, la campagne a débuté le 2 septembre et s’est poursuivie durant deux mois. Le site www.attention-batteries.ch a été développé pour rappeler certains principes de base visant à minimiser le risque dans la manipulation et la recharge des batteries.
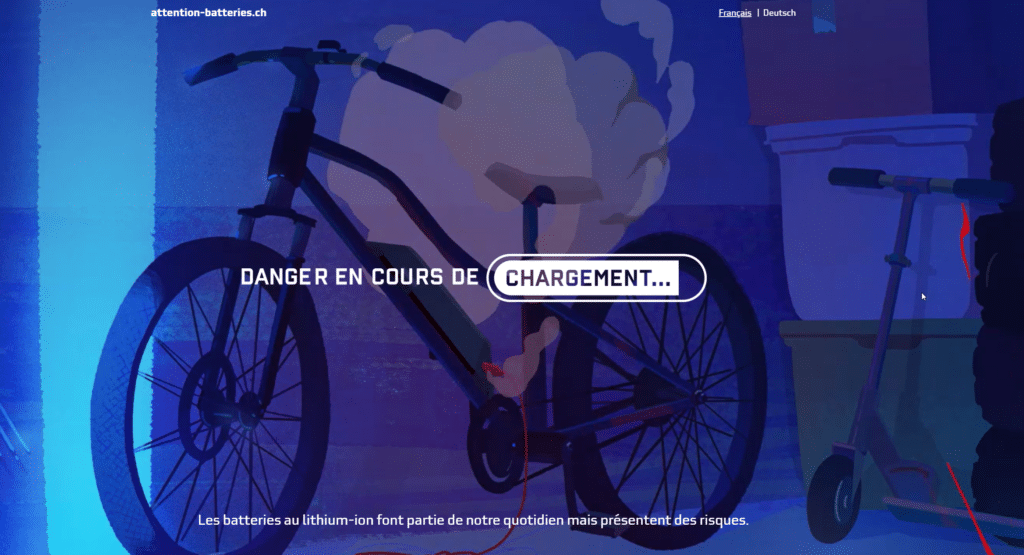
Formations
Après le renouvellement des autorités communales, intervenu en cours d’année, les commissions de police du feu ont connu de nombreux changements. Afin de former les nouveaux membres, les cours organisés par l’ECAP à leur intention de sont déroulés les 5 et 19 novembre à EspaceVal à Couvet. Ils ont réuni 113 commissaires pour une journée complète de formation. Afin de répondre aux besoins des débutants et des membres confirmés des commissions, deux programmes distincts ont été proposés. Le premier avait pour thématique centrale la visite d’un bâtiment d’habitation avec les problématiques du compartimentage coupe-feu, des voies d’évacuation ou des éclairages de sécurité. Le second abordait la question plus complexe d’un bâtiment à affectations multiples et traitait, dans le cadre de deux ateliers, des Sprinkler et des systèmes de détection, puis des installations de désenfumage et des éclairages de sécurité.
Divers
Permis de construire
Le nombre de dossiers de permis de construire soumis à l’ECAP en 2024 pour préavis, sous l’angle de la prévention contre les incendies et les éléments naturels, d’une part et celui des sapeurs-pompiers d’autre part, s’est sensiblement réduit enregistrant une diminution de l’ordre de 15%. Durant l’exercice écoulé, 1492 demandes ont été préavisées en matière de prévention incendie, 1346 pour la prévention EN et 1567 en ce qui concerne l’accessibilité des forces d’intervention et la disponibilité en eau d’extinction.
Ramoneurs
En 2022, l’ECAP, le Service de la sécurité civile et militaire ainsi que l’association neuchâteloise des ramoneurs entamaient des réflexions sur l’évolution de la profession. Divers constats, liés notamment aux changements de technologie des moyens de chauffage, ont montré que le cadre réglementaire actuel n’était plus adapté aux contexte actuel. Grâce à une collaboration étroite entre les différents partenaires impliqués, un projet de nouvelle réglementation a été élaboré. Il prévoit l’assouplissement du monopole en ouvrant aux entreprises de ramonage agréées l’accès à tout le territoire cantonal. Les conventions liant un maître-ramoneur et une commune seraient ainsi abolies permettant à chaque détenteur d’une installation thermique de faire appel à l’entreprise de son choix. Dans cette constellation, l’ECAP conserverait un rôle de surveillance grâce à une plateforme informatique enregistrant les contrôles et nettoyages effectués. Ce système offrirait aussi au service de l’énergie et de l’environnement la possibilité de vérifier les vignettes de contrôle de combustion des installations de chauffage. Le dossier sera traité par le Conseil d’Etat au début de 2025.
Intervention
04
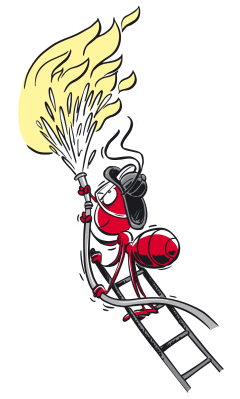
L’évolution de la sinistralité oblige les acteurs de l’Intervention à s’adapter constamment tant aux nouveaux risques, feux de forêt ou voitures électriques, qu’aux nouvelles techniques d’extinction. Le rôle de l’ECAP, fixé par la loi, est notamment de s’assurer que les sapeurs-pompiers disposent de la formation et du matériel adéquat à des coûts comparables à ceux des autres cantons.
Cette responsabilité implique une collaboration étroite avec de nombreux partenaires, tant au sein des régions de défense incendie du canton que des instances extra-cantonales.
Formation
Cours
La modification des contextes technique, environnemental et social dans lesquels les sapeurs-pompiers évoluent, requière une mise à jour permanente des offres de cours, dans le cadre de cursus de formation adaptées aux changement de la société. Considérant que la période durant laquelle un volontaire s’engage est toujours plus courte, la formation doit lui permettre d’être plus rapidement opérationnel, tout en garantissant son efficacité et sa sécurité.
Le centre de formation de Couvet prend en compte ces différents paramètres pour élaborer son programme annuel de cours. En 2024, ce sont ainsi 74 cours (2023 : 62) qui ont été organisés en priorité pour les pompiers, sapeurs ou cadres, débutants ou confirmés. Des formations spécifiques ont également été mises sur pied pour des participants externes à la défense incendie, en particulier les groupes de première intervention en entreprise (GIE). Ce sont ainsi un millier de personnes qui ont participé à ces formations, totalisant 1872 jours/hommes d’instruction.
Les cours fédéraux d’instructeurs et la formation des sapeurs-pompiers professionnels accueillis à Couvet représentent aussi une part importante de l’activité avec un niveau d’exigences élevé tant en matière d’infrastructures que de qualité de la logistique. Les 15 cours organisés en 2024 ont impliqué 103 participants pour plus de 4.2 jours de formation par personne. Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de 2023 en raison du cursus biennal de l’académie latine qui reviendra à Couvet en 2025.
Plus anecdotiquement, il faut mentionner qu’une journée d’activités a également été organisée le 14 octobre à l’intention d’élèves dans le cadre du passeport vacances.
Piste d’instruction
Conformément au principe initial du projet, la construction de la piste s’est poursuivie en garantissant le maintien des formations sur le site. C’est ainsi que les travaux se sont concentrés sur la partie est du chantier permettant le déroulement des cours dans le secteur ouest. Durant l’année écoulée, les aménagements intérieurs du bâtiment logistique et administratif ont pu démarrer. La construction du bâtiment multifonctions destiné notamment à la formation à la lutte contre les inondations s’est achevée en coordination avec la réalisation des cuves de récupération des eaux pluviales et de ruissellement. La base des infrastructures dévolue à la formation des astreints à la protection civile a également été terminée.
L’avancement des travaux a permis de fixer la date de l’inauguration officielle au 12 septembre 2025. Elle sera suivie le lendemain d’une journée portes ouvertes permettant aux sapeurs-pompiers et, de façon plus générale, à l’ensemble de la population intéressée de découvrir le nouveau centre de formation cantonal.

Inspectorat
Support aux interventions et suivi
Les 7 membres de l’inspectorat qui se partagent le service de piquet, outre leur fonction au sein de l’ECAP, sont intervenus 68 fois (2023 : 53) dans l’année sur demande de la CNU (Centrale neuchâteloise d’urgence). Leur rôle est d’appuyer le chef d’intervention si cela s’avère nécessaire, de coordonner le recours à des partenaires externes et, dans les cas de dommages à un bâtiment, d’organiser le suivi du sinistre par le secteur Assurance de l’ECAP. L’inspectorat est également responsable de veiller au respect des standards de sécurité cantonaux qui définissent le temps mis par les pompiers pour arriver sur le site d’un sinistre et la conformité des ressources au type d’intervention. Pour mémoire, le taux de respect des différents standards, en fonction de la mission, est fixé par arrêté cantonal à 80% sur l’année, tenant en compte les conditions du trafic, la météo ou les interventions simultanées. En 2024, le taux de respect des standards, pour les 2’048 missions considérées répondait aux exigences.
| Région | Taux de respect pour les missions Feu/EN | Taux de respect pour les missions de secours |
|---|---|---|
| Littoral | 98.69% | 95.29% |
| Montagnes | 98.81% | 96.87% |
| Val-de-Ruz | 97.83% | 100% |
| Val-de-Travers | 100% | 88.24% |
Costradis
La Commission stratégique de la défense incendie et des secours s’est réunie à quatre reprises en 2024. Les missions communautaires sanitaires que sont le relevage, l’aide au portage et l’évacuation sanitaire ont continué d’occuper les débats des deux premières séances. La modification des arrêtés concernés par le Conseil d’Etat n’étant finalement intervenue que dans le courant du premier semestre, l’intégration de ces missions dans les comptes du fonds des missions de secours a été effective dès le 1er juin 2024.
Lors de la séance du 17 septembre, c’est une commission forte de deux nouveaux membres, suite aux élections communales, qui a approuvé le budget 2025 présentant un coût par habitant de CHF 13.73 (budget 2024 : CHF 13.37) et un total d’investissements de 430’000 francs.
Il est à noter que ces investissements incluent l’acquisition d’un véhicule d’extinction destiné aux feux de forêt et aux zones rurales en général. Cet achat interviendra dans le cadre d’une coordination entre cantons romands en vue de la mise en place d’un concept commun. L’accent mis sur cette problématique a aussi incité les instances cantonales à envoyer plusieurs cadres sapeurs-pompiers suivre des formations spécifiques dans le Sud de la France.
Dans une perspective à plus long terme, la stratégie hydraulique cantonale a été présentée lors de la séance du mois de novembre. Elle vise à donner un premier aperçu des besoins des sapeurs-pompiers en véhicules et matériel issus d’un concept développé par les commandants de région et l’ECAP.
Centrale neuchâteloise d’urgence (CNU)
Selon la loi, l’ECAP est chargé « d’inspecter la centrale chargée de la mobilisation des sapeurs-pompiers et de contrôler l’efficacité de l’alarme et de l’engagement ». Cette responsabilité commence par l’établissement de protocoles d’engagement qui garantissent la proportionnalité des moyen engagés et le respect du standard cantonal de sécurité.
En 2024, les opérateurs de la CNU ont répondu à 4’380 appels au numéro 118. Le temps d’attente moyen des appelants a été de 6,59 secondes, correspondant ainsi aux recommandations de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP).
Promotions des sapeurs-pompiers
Après 5 ans de gestion du mandat qui a vu de nombreuses réalisations en faveur de la promotion des sapeurs-pompiers volontaires, l’ECAP a remis le flambeau à son homologue fribourgeois. Le bilan est très satisfaisant puisque l’hémorragie des effectifs a pu être stoppée et que des augmentations de nouvelles incorporations sont constatées dans plusieurs cantons.
Initialement soutenue par les quatre cantons romands dotés d’un ECA (VD, FR, NE et JU), la campagne a ensuite séduit le Valais en 2022. En 2024, c’est le canton de Soleure qui a rejoint l’initiative. D’autres cantons pourraient également s’y associer à l’avenir.
Dans le même cadre, le nombre d’entreprises et collectivités neuchâteloises ayant adhéré au label « Employeur Partenaire » a passé de 13 à 16 en 2024.
Nominations et remerciements
Le 5 décembre a eu lieu la désormais traditionnelle soirée de nomination et de remerciement des partenaires de la défense incendie et du centre de formation de Couvet. À cette occasion, plus de 90 invités ont assisté à la remise de différents titres et diplômes. Il a notamment été procédé à la nomination de 4 nouveaux instructeurs fédéraux, arrivés au terme de leur cursus de formation.
Lors de cette cérémonie, ont également été nommés 8 instructeurs cantonaux pour les jeunes sapeurs-pompiers, 5 spécialistes incendie et 3 formateurs de spécialistes incendie.

Défense incendie
Adduction d’eau
Le 14 mars 2024, l’ECAP a organisé une conférence destinée aux autorités communales et aux spécialiste dans le domaine de l’eau, fontainiers et planificateurs, notamment. Au travers de plusieurs présentations, la problématique de l’adduction en eau d’extinction a été abordée sous l’angle des normes, des besoins des sapeurs-pompiers, de la responsabilité des acteurs et des subventions offertes par l’ECAP. L’après-midi s’est clôturé par plusieurs démonstrations mettant en œuvre les moyens hydrauliques utilisés pour la défense incendie en lien avec les bornes hydrantes.
Durant l’année sous revue, 57 nouveaux dossiers ont été ouverts dans ce cadre par l’ECAP. Il s’agit de demandes de subventions pour des bornes hydrantes, des citernes et des réserves incendie, des conduites d’eau avec pose d’hydrants et la réalisation de plan communaux d’alimentation. Le montant des subventions versées, y compris celles issues de promesses antérieures, totalise 497’000 francs, soit un montant en forte hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années (308’000 francs). La provision pour des travaux reconnus par l’ECAP, mais non encore réalisés culmine à 1.56 million de francs.
Missions de secours
Le contrat de prestations qui lie l’ECAP à l’Etat a été revu en 2024 avec l’adjonction des missions dites de «secours communautaires sanitaires» dans le catalogue des missions confiées par le canton à l’établissement. Le relevage, l’aide au portage et les évacuations sanitaires seront gérés à l’avenir dans le cadre du fonds des missions de secours au même titre que la défense chimique et contre les hydrocarbures, le secours routier et les interventions en milieu périlleux (GRIMP), notamment.
Pour mémoire, ces missions, réalisées sans financement de l’ECAP, sont payées par les communes au prorata de leur population. Toutes les interventions sont menées sous l’égide des deux corps professionnels. La facturation des coûts d’intervention aux personnes ou entreprises responsables constitue également une part significative des revenus.

Mousse fluorée
En particulier lors de feux d’hydrocarbures, l’utilisation de mousse d’extinction contenant des agents fluorés (PFAS) est longtemps restée la norme chez les sapeurs-pompiers, principalement due à l’absence de solutions alternatives efficaces. La nocivité de ces composés alkyles perfluorés et polyfluorés pour l’environnement et la santé est largement démontrée et est accentuée par leur stabilité qui fait qu’ils sont parfois désignés comme des «polluants éternels». Conscient de ce problème, l’ECAP en collaboration avec les régions de défense incendie et la Raffinerie de Cressier a mis en place un programme d’élimination rapide de ces mousses et leur remplacement par des agents moussants sans fluor. Financées majoritairement par le fonds des missions de secours, la destruction des stocks existants, la décontamination des véhicules et l’acquisition de produits de substitution ont été réalisées en 2024. Les pompiers neuchâtelois ont ainsi fait œuvre de pionniers en Suisse.
Feux de forêt
Avec le changement climatique et les longues périodes de sécheresse que le canton connaît, la problématique est devenue depuis quelques années une préoccupation croissante des sapeurs-pompiers. La mission de lutte contre les feux de forêt et de végétation fait partie depuis 2020 du périmètre des missions de secours gérées par l’ECAP. Pour rappel, une typologie d’événements à trois niveaux a été définie, impliquant des intervenants différents en fonction de l’importance du feu. Le niveau 1 est un feu maîtrisable sans moyens particuliers par les sapeurs-pompiers locaux, le niveau 2 requérant une formation spécifique a été déléguée à la Région de défense incendie du Val-de-Ruz qui dispose de matériel dédié. Le niveau 3 requiert une coordination par l’état-major de crise cantonal.
L’année 2024 a vu la mise en place de filières de formation pour les sapeurs et les cadres. La formation de base inclura dorénavant un module de formation consacré à ce thème afin que tous les pompiers disposent des connais-sances nécessaires aux interventions de niveau 1. Pour ce faire, deux cadres neuchâtelois ont participé à une formation dans le Var (France) pour acquérir les compétences nécessaires.
En parallèle, une coordination avec les cantons de Vaud et Genève est en place afin de définir les matériels et véhicules requis et permettre une complémentarité et une interopérabilité des ressources des 3 cantons.
Régions – Évolution du nombre de sapeurs-pompiers
Malgré les efforts conjugués des régions et de l’ECAP pour susciter des vocations et recruter de nouveaux volontaires, les effectifs des différents corps régionaux peinent à se renouveler. L’organisation d’une journée de recrutement cantonale, une présence appuyée dans les médias et sur les réseaux sociaux ainsi qu’une communication personnalisée dans les régions ne suffisent pas à assurer la disponibilité de suffisamment de sapeurs-pompiers dans certains points de départ, principalement en journée.
Pour les régions dotées d’un DPS1, une partie de la réponse à ce défi réside certainement dans une meilleure intégration des volontaires au sein des corps professionnels. Le résultat des initiatives prises dans ce sens par la région Littoral, avec le soutien de l’ECAP, s’annonce prometteur, mais il faudra encore quelques années pour en mesurer le réel impact et transposer le modèle dans les Montagnes.
En 2024, le commandement des régions a été assumé comme suit :
| Région Littoral | |
| Commandant de région | lt-col. Stéphane Cosandier |
| Chef des sapeurs-pompiers volontaires | cap. Patrick Vuilleumier |
| Région Val-de-Travers | |
| Commandant de région | maj. Patrick Piaget |
| Région Val-de-Ruz | |
| Commandant de région | maj. David Balmer |
| Région des Montagnes | |
| Commandant de région | lt-col. Grégory Duc |
| Chef des sapeurs-pompiers volontaires | cap. Hervé Lara |
Administration
05Placements
Dans un contexte géopolitique chahuté et après une année 2023 assez exceptionnelle, la prudence était de mise sur les marchés boursiers. Il n’en aura finalement rien été et, malgré quelques corrections ponctuelles, les résultats auront dépassé les prévisions les plus optimistes.
Malgré une allocation toujours prudente et une orientation ESG de ses placement, l’ECAP aura pu pleinement profiter de ce bel exercice et consolider ainsi ses réserves. Le rendement des placements au 31.12 atteint 6.42%.
Immobilier direct
Conformément à la stratégie fixée, la gestion du parc immobilier détenu en direct par l’ECAP s’est concentrée sur la valorisation des objets existants, plutôt que sur une croissance par de nouvelles acquisitions.

- Après la rénovation de son enveloppe en 2023, les travaux dans l’immeuble de la rue de la Fiaz 15 à La Chaux-de-Fonds se sont terminés avec la mise en place de mesures de protection contre le ruissellement et la rénovation d’un appartement supplémentaire.
- L’assainissement énergétique et la surélévation du siège historique de l’ECAP à la Place Pury s’est achevé en fin d’année. Le bâtiment dispose ainsi d’un étage supplémentaire de bureaux, son isolation a été notablement améliorée et le toit est dorénavant équipé d’une installation photovoltaïque de 12.8 kWc. Ce chantier a été mené conjointement avec la transformation par leur locataire des surfaces commerciales situées au rez-de-chaussée et au premier étage.
- Le permis de construire pour la réhabilitation de la Maison Rousseau à Môtiers est en force. Les premières étapes des travaux ont été lancées. Le projet de création d’une nouvelle offre d’hébergement au Val-de-Travers est donc en bonne voie. Les travaux lourds devraient pouvoir être lancés dès le printemps 2025.
Seule exception notable, le nouveau Data Center des Cadolles, fruit d’un partenariat entre l’Etat et l’ECAP, dont l’inauguration a eu lieu le 16 décembre. Cet immeuble complète ainsi le pool informatique des Cadolles, composé de trois bâtiments, propriété de l’ECAP et exploités par le Service informatique de l’Entité neuchâteloise.
Comité de placement
Après l’actualisation du règlement de placement entériné par la Chambre d’assurance immobilière le 19 mars 2024, le comité de placement a décidé de finaliser l’harmonisation des règles de placement entre les différents partenaires externes. Ainsi le dernier mandat qui disposait d’une stratégie particulière a été converti et fonctionne dorénavant avec la même allocation d’actifs que les autres. Selon ce principe, chaque mandataire travaille avec les mêmes pourcentages pour chaque catégorie d’actifs, mais peut appliquer sa propre stratégie en matière de choix des titres, de gestion active ou passive ou de couvertures des risques de change. Les mandats sont comparés sur la base de leur performance nette de frais.
Informatique
La digitalisation de l’ECAP se poursuit. Mis en service, dans son socle de base, en mars 2023, le nouveau logiciel de gestion de l’ECAP, PEGGI, a été complété par diverses fonctionnalités, notamment au bénéfice de la prévention et de l’intervention. C’est ainsi que la gestion des plans d’aménagement ou la facturation des abonnements d’alarmes automatiques sont maintenant réalisés sur la même plateforme.
Portail client
La première étape de la mise à disposition d’un portail client permettant aux assurés d’interagir avec l’ECAP de manière centralisée a été réalisée en 2024. Grâce à un sondage adressé à 10’102 clients, les attentes des propriétaires de bâtiments ont pu être mieux cernées et priorisées. L’objectif est de pouvoir leur offrir une plateforme en ligne sécurisée qui simplifie l’échange des documents, l’obtention d’informations sur leurs dossiers ou la gestion de leurs données. Les propriétaires bénéficieront ainsi de divers services d’abord centrés sur les sinistres, mais dont la gamme est appelée à s’étoffer.
Durabilité
La durabilité est solidement ancrée dans le modèle économique des établissements cantonaux d’assurance (ECA). Cette réalité se manifeste en particulier dans le domaine de la prévention. En effet, tout dommage évité se traduit par des ressources épargnées, qui ne devront pas être mobilisées pour la remise en état de bâtiments endommagés. Ce système contribue de ce fait à réduire l’empreinte écologique. La prévention passe également par l’information des propriétaires de bâtiments sur les risques et les mesures de protection. Ce faisant, les ECA participent activement à la sensibilisation aux questions de durabilité et encouragent les changements de comportement en faveur de la protection de l’environnement. Présidé par le directeur de l’ECAP, le comité Durabilité des ECA s’est penché sur deux thèmes centraux en 2024. D’une part, il a élaboré un aperçu des indicateurs-clés de performance mesurés par les différents établissements d’assurance, puis il a comparé leur compatibilité. Cet aperçu sera mis à la disposition de tous les ECA en tant que référence de bonnes pratiques. D’autre part, le comité a rédigé un catalogue de mesures visant à sensibiliser les collaborateurs des ECA au thème de la durabilité.
Placements mobiliers
Sans fixer d’objectifs contraignants à ses mandataires, l’ECAP les encourage à porter une attention particulière à la durabilité de leur portefeuille. Une notation annuelle est mise en place afin de suivre l’évolution du rating général de chaque mandat, de la présence d’activités controversées et de l’empreinte carbone.
Les résultats 2024 montrent une amélioration du rating global des placements mobiliers dont la note passe de 7.36 à 7.58. La part des titres classés en AAA et AA passe de 34.9% à 37.7% (2022 : 31.65).
L’intensité carbone est calculée en tonnes de CO2 par million de chiffre d’affaires. Elle couvre le scope 1 (émissions directes, issues de combustibles fossiles ou de processus industriels) et le scope 2 (émissions indirectes associées à la production d’énergie importée pour les activités de l’organisation). Le score du portefeuille de l’ECAP montre une réduction de 12.82% entre 2023 et 2024 (59.74 ; 52.08), nettement supérieure à celle enregistrée par la moyenne des fonds balancés du marché (-1.79%).
Relativement simple à réaliser, cette mesure présente l’avantage de permettre la comparaison par rapport à un benchmark et le suivi de l’évolution de la performance du portefeuille dans le temps.
Placements immobiliers
Durant l’année écoulée, l’ECAP a poursuivi ses efforts en matière de durabilité de son parc immobilier. Ainsi les travaux réalisés dans les immeubles de la rue de la Fiaz à La Chaux-de-Fonds et de la place Pury à Neuchâtel vont permettre de réduire la consommation et la dépendance aux énergies fossiles. Dans la même lignée, il est prévu de se pencher en 2025 sur deux autres bâtiments nécessitant également des travaux importants pour améliorer leur efficience énergétique.
Afin de mieux mesurer la durabilité de son patrimoine immobilier et son évolution, l’ECAP, en collaboration avec sa gérance immobilière, va mettre en place, dès 2025, un suivi systématique du bilan carbone de chacun de ses bâtiments.
Très concrètement, l’ECAP a installé en 2024 plus de 60 m2 de panneaux photovoltaïques sur son siège de la place de la Gare. L’objectif est de pouvoir couvrir une part importante des besoins de l’exploitation courante de l’établissement et des chambres d’hôtel des 3e et 4e étages. L’installation de bornes de recharge pour des véhicules électriques interviendra dès le début de 2025.
Organisation
06Chambre d’assurance immobilière
Au 31 décembre 2024, la composition de la Chambre d’assurance immobilière est la suivante :
| Président : | M. le conseiller d’État, Alain Ribaux, Neuchâtel |
| Vice-présidente : | Mme Manuela Surdez, La Chaux-de-Fonds |
| Membres : | Mme Katia Guillod, Fontaines Mme Valérie Patthey, Môtiers M. Yanis Callandret, Neuchâtel M. Denis Clerc, La Chaux-de-Fonds M. Thierry Grosjean, Auvernier |
Étant donné sa décision de ne pas briguer un quatrième mandat lors des élections cantonales, l’exercice 2024 aura été le dernier entièrement réalisé sous la présidence de M. le conseiller d’Etat A. Ribaux. En fonction depuis 2013, il aura conduit l’ECAP au travers de plusieurs épisodes marquants de son histoire, de l’intégration des sapeurs-pompiers en 2013 à la tempête de La Chaux-de-Fonds en 2023. Sa présidence pragmatique, efficace et attentive sous l’angle financier aura permis à l’ECAP de pleinement jouer son rôle d’établissement de droit public, respectant à la fois les principes de l’Etat tout en profitant de son autonomie pour mener efficacement de nombreux projets au profit de la population neuchâteloise.
Organigramme
Experts externes
| Yves Affolter | Neuchâtel |
| Cédric Aklin | Bevaix |
| Denis Bongini | Chaumont |
| Géraldine Chapatte | Les Bois |
| Denis Cherbuin | Môtiers |
| Olivier Ciampi | La Chaux-de-Fonds |
| Karin Davies | La Chaux-de-Fonds |
| Silvia de Oliveira | Fleurier |
| Fabienne Denoréaz Paul | Neuchâtel |
| Michaël Desaules | Neuchâtel |
| Sophie Erard | Le Landeron |
| André Escobar | Neuchâtel |
| Christophe Farine | Valangin |
| Sabine Girardin | La Chaux-de-Fonds |
| Florence Hippenmeyer | Chaumont |
| Mark Hübscher | Neuchâtel |
| Florian Kocher | Neuchâtel |
| Olivier Kohli | Le Pâquier |
| Delphine Lieffroy | Bevaix |
| Vincent Mortilla | Cornaux |
| Martin Mouzo | Cormondrèche |
| Sabrina Pais | Neuchâtel |
| Chantal Préat Allanfranchini | Neuchâtel |
| Mélanie Rodriguez | Cernier |
Organe de révision
| Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds |
Finances
07Résultats généraux
L’adoption par l’ECAP, il y a plus de 10 ans, des recommandations SwissGAAP a entrainé une volatilité accrue des résultats annuels. Ces principes comptables obligent en effet l’ECAP à donner une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats. En raison de l’interdiction de constituer des réserves latentes ou non spécifiquement affectées, le résultat annuel se reflète directement dans la variation du capital de l’établissement. Seules des provisions pour risques liés aux placements de capitaux ainsi que des provisions techniques pour fluctuation et sécurité sont autorisées, en raison des spécificités de l’activité d’assureur.
C’est ainsi qu’après la perte historique de l’année 2023 (24.1 millions de francs), la conjonction d’une sinistralité basse et d’un bon rendement des capitaux investis permet de clore l’exercice 2024 avec un bénéfice remarquable de 26’682’947 francs.
Assurance
Les produits de l’assurance issus des primes sont en progression de 5.5% pour un total de 30.09 millions de francs, reflétant l’effet de l’adaptation de l’indice au prix de la construction.
La charge nette des sinistres est en forte baisse par rapport à 2023 (-68.70%). Elle retrouve ainsi un niveau proche de celui de 2022, qui n’avait été marqué par aucun événement extraordinaire. Par contre, les primes payées au titre de la réassurance augmentent sensiblement en raison de la sinistralité des dernières années, la hausse moyenne atteint 17.8% et elle est particulièrement élevée pour la réassurance des sinistres dus aux éléments naturels qui augmentent de 35%.
Les autres charges d’exploitation sont extrêmement stables, enregistrant même une légère baisse de 1.8%.
Le résultat technique présente un excédent de recettes de 6.6 millions de francs, à mettre en parallèle des 24.6 millions de perte en 2023.
Prévention
Frais de communication en baisse, charges d’informatique en hausse, mais une stabilité globale des dépenses (1.8%) par rapport à 2023. L’exercice 2024 de la prévention traduit bien les points forts de l’activité, à savoir le passage de la campagne « Pas dans ma maison » d’une phase de lancement à une consolidation et un effort accru mis sur la plateforme ECAPrev.
Le versement des diverses subventions au titre de la protection contre les incendies et les éléments naturels sont stables, mais les engagements au titre des promesses augmentent de 172’000 francs après une forte baisse l’année précédente.
Le solde positif de l’activité permet une attribution au fonds pour la prévention des dommages de 0.988 million de francs.
Intervention
Les produits progressent globalement de 3.37%, malgré une baisse ponctuelle des loyers encaissés pour la mise à disposition des véhicules aux régions de défense incendie. La contribution des assureurs privés au travers du « sou d’extinction » atteint les 1.28 million de francs. Les facturations de prestations liées à l’organisation de cours pour des tiers et de mise à disposition d’infrastructures progressent de 8.4% à plus de 308’000 francs.
À l’exception d’une hausse des frais de locaux découlant de l’amortissement des investissements réalisés à la piste de la Presta, les autres charges d’exploitation du secteur baissent de 3.0%.
Si les subventions versées aux sapeurs-pompiers pour la formation, le matériel et les véhicules sont stables, le soutien de l’ECAP aux adductions d’eau (paiements et promesses) a fortement augmenté, passant de 368’000 francs en 2023 à 614’000 en 2024.
Avec un excédent de charges de 1.26 million de francs, prélevé au fonds pour l’intervention, la réduction de ce fonds se poursuit selon la planification financière établie.
Missions de secours
Les comptes 2024 des missions de secours affichent un résultat tout à fait réjouissant pour les communes qui en assurent le financement. En effet les charges se révèlent sensiblement inférieures au budget (-2.44%) et, surtout, les produits dépassent de 7.5% les prévisions. L’intégration différée des missions communautaires sanitaires dans les comptes est un facteur faussant quelque peu la comparaison, mais qui ne suffit pas à expliquer l’écart.
Au chapitre des produits, la principale variation provient de la refacturation des interventions aux responsables d’événements. Bien que le tarif cantonal n’ait pas évolué depuis 2014, ce poste atteint un niveau record et dépasse pour la première fois le million de francs.
En ce qui concerne les charges, le haut niveau d’activité transparaît des comptes de frais d’intervention, de soldes des volontaires et d’entretien du matériel, celui-ci ayant été beaucoup sollicité. La variation des coûts d’amortissement et de location des véhicules est liée à des livraisons de véhicules budgétées en 2024 mais qui n’ont pas encore été réceptionnées et qui n’interviendront que sur l’exercice suivant.
Placements des capitaux
Les produits issus des placements mobiliers et immobiliers atteignent 26.1 millions de francs dépassant ainsi de 26.5% la performance de 2023 qui était déjà considérée comme très bonne. La part des gains réalisés, par rapport aux variations de cours non encaissées, progresse de 41.7 à 44.7%.
Conformément aux normes comptables SwissGAAP, la réestimation de cinq immeubles a été faite selon la méthode DCF, cette démarche a conduit à un amortissement de travaux d’entretien pour 1.33 millions de francs.
Le portefeuille de placements se monte à 334.4 millions de francs en très légère baisse (-0.72%), malgré les gains, en raison de prélèvements effectués pour assumer les charges de sinistres de 2023. Le bénéfice dégagé en 2024 atteint 22.1 millions de francs.
Révision et approbation des comptes
Pour la quatrième et dernière année de son mandat, la Fiduciaire Leitenberg & Associés SA a, à nouveau, réalisé sa révision en deux étapes. Au début du mois de décembre 2024, elle a mené un audit préliminaire centré sur le système de contrôle interne. Les entretiens et sondages réalisés à cette occasion ont principalement porté sur la définition de l’environnement de contrôle, les contrôles informatiques, les facturations de primes et d’abonnements, ainsi que les processus liés aux sinistres, aux subventions ainsi qu’aux finances.
L’audit comptable proprement dit et la révision des comptes 2024 ont eu lieu la semaine du 24 février 2025.
Les comptes ont été approuvés par la Chambre d’assurance immobilière lors de sa séance du 2 avril 2025, en présence de l’auditeur.
Rapport de révision
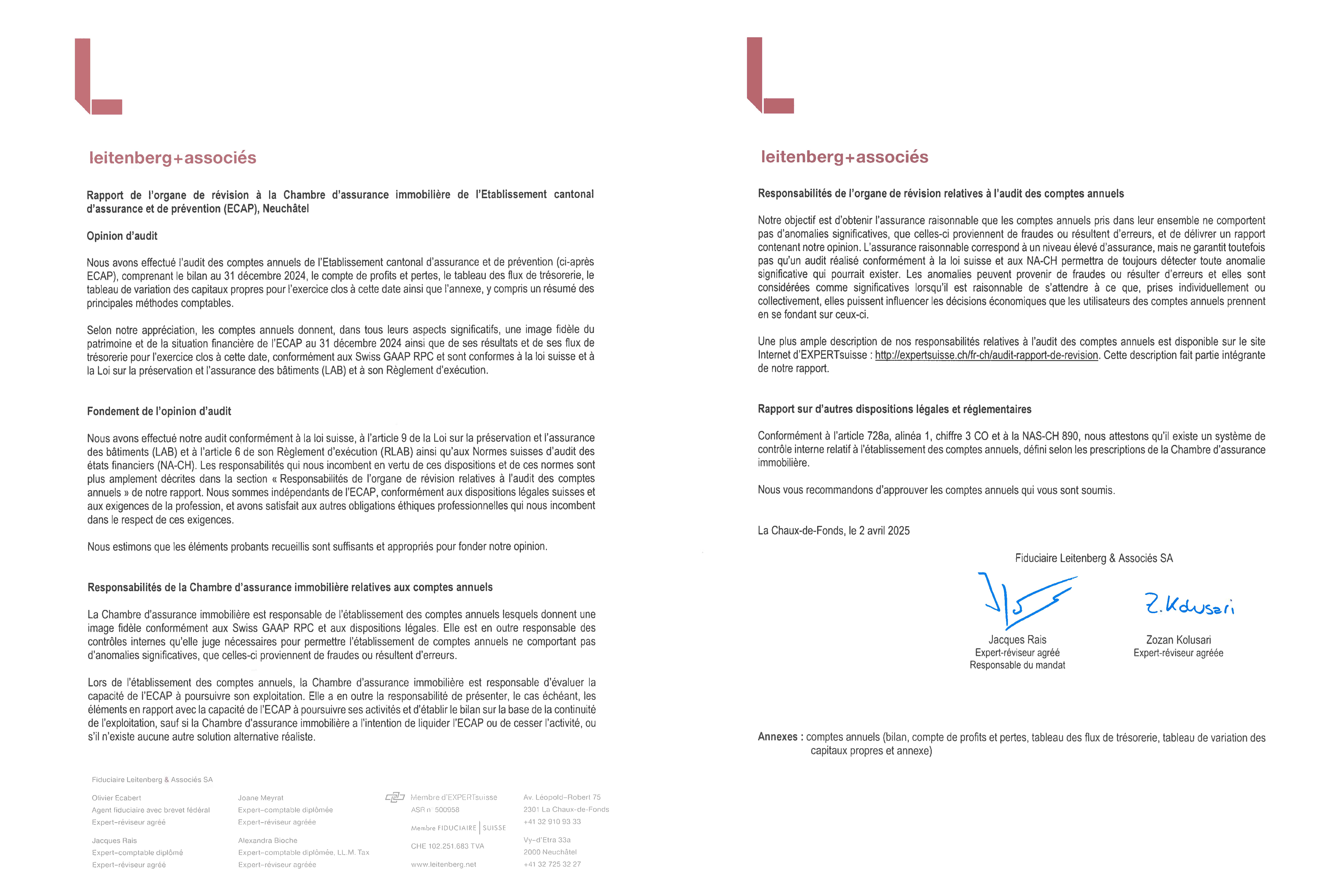
Bilan
08
| Chiffres en milliers de francs | Explications | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| **Actif | ||||
| *Actifs immobilisés | ||||
| Placements de capitaux | 1 | 334’436 | 336’872 | -2’436 |
| Participations | 2 | 8’367 | 8’412 | -45 |
| Immobilisations incorporelles | 3 | 554 | 768 | -214 |
| Immobilisations corporelles | 16’854 | 16’191 | 663 | |
| #Total Actifs immobilisés | 360’210 | 362’243 | -2’032 | |
| *Actifs circulants | ||||
| Actifs de régularisation | 4 | 1’033 | 4’405 | -3’371 |
| Créances | 5 | 2’431 | 1’867 | 564 |
| Liquidités | 18’378 | 13’685 | 4’693 | |
| #Total Actifs circulants | 21’842 | 19’956 | 1’886 | |
| ##Total Actif | 382’052 | 382’199 | -147 | |
| **Passif | ||||
| *Capitaux propres | ||||
| Réserves provenant des bénéfices accumulés | 194’541 | 218’656 | -24’115 | |
| Résultat net de l’exercice | 26’683 | -24’115 | 52’798 | |
| #Total Capitaux propres | 221’224 | 194’541 | 26’683 | |
| *Capitaux étrangers | ||||
| Provisions techniques d’assurance | 6 | 689 | 25’524 | -24’835 |
| Provisions techniques pour fluctuation et sécurité | 7 | 45’679 | 44’317 | 1’362 |
| Provisions non techniques | 8 | 53’528 | 51’664 | -136 |
| Provisions pour risques liés aux placements de capitaux | 9 | 46’959 | 48’863 | -1’903 |
| Passifs de régularisation | 10 | 8’799 | 7’909 | 890 |
| Dettes | 11 | 5’173 | 9’381 | -4’208 |
| #Total Capitaux étrangers | 160’828 | 187’658 | -26’830 | |
| ##Total Passif | 382’052 | 382’199 | -147 |
Compte de profits et pertes
09| Chiffres en milliers de francs | Explications | 2024 | 2023 | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Produits des primes nettes d’assurance | 30’093 | 28’521 | 1’572 | |
| Primes de la réassurance | 12 | -5’635 | -4’785 | -851 |
| *Primes acquises pour propre compte | 24’458 | 23’737 | 721 | |
| Charges nettes des sinistres | 13 | -11’347 | -36’251 | 24’904 |
| Variation des provisions techniques et des provisions pour fluctuation et sécurité | 14 | -1’348 | -6’817 | 5’469 |
| Charges d’exploitation | 15 | -5’184 | -5’313 | 129 |
| Autres produits d’exploitation | 48 | 50 | -2 | |
| Autres charges d’exploitation | -26 | 0 | -26 | |
| *Résultat technique | 16 | 6’601 | -24’594 | 31’196 |
| Produits pour la prévention | 5’071 | 4’779 | 291 | |
| Charges pour la prévention | -4’083 | -4’158 | 74 | |
| Variation des provisions non techniques pour la prévention | -987 | -622 | -366 | |
| *Résultat pour la prévention des dommages | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Produits pour l’intervention | 8’390 | 8’122 | 268 | |
| Charges pour l’intervention | -9’732 | -9’166 | -556 | |
| Variation des provisions non techniques pour l’intervention | 1’342 | 1’044 | 298 | |
| *Résultat pour l’intervention | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Produits pour les missions de secours | 3’904 | 2’843 | 1’061 | |
| Charges pour les missions de secours | -3’697 | -2’898 | -799 | |
| Variation des provisions non techniques pour les missions de secours | -207 | 55 | -262 | |
| *Résultat pour les missions de secours | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Produits des placements de capitaux | 20 | 24’804 | 21’473 | 3’331 |
| Charges des placements de capitaux | 21 | -4’626 | -6’631 | 2’005 |
| *Résultat des placements de capitaux avant variation des provisions pour risques liés aux placements de capitaux | 22 | 20’178 | 14’842 | 5’336 |
| Variation des provisions pour risques liés aux placements de capitaux | 23 | 1’903 | -14’363 | 16’266 |
| *Résultat des placements de capitaux | 22’082 | 480 | 21’602 | |
| *Résultat d’exploitation | 28’683 | -24’115 | 52’798 | |
| *Résultat hors exploitation | 24 | -2’000 | 0 | -2’000 |
| *Bénéfice/perte | 26’683 | -24’115 | 50’798 |
Flux de trésorerie
10| Chiffres en milliers de francs | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| *Flux de trésorerie relatif à l’exploitation | ||
| Bénéfice/Perte | 26’683 | -24’115 |
| Pertes réalisées ou non sur placements de capitaux | 3’349 | 4’314 |
| Bénéfices réalisés ou non sur placements de capitaux | -20’816 | -15’931 |
| Amortissements sur immobilisations incorporelles | 448 | 564 |
| Amortissements sur immobilisations corporelles | 2’777 | 2’443 |
| Variation des provisions techniques d’assurance | -24’835 | 8’750 |
| Variation des provisions techniques pour sécurité et fluctuation | 1’362 | 7’010 |
| Variation des provisions non techniques | -1’864 | -8 |
| Variation de la provision pour risques liés aux placements de capitaux | -1’903 | 14’363 |
| Variation des créances | -564 | 387 |
| Variation des actifs de régularisation | 3’371 | -3’702 |
| Variation des engagements | -4’208 | 3’239 |
| Variation des passifs de régularisation | 890 | 7’239 |
| #Flux de trésorerie relatif à l’exploitation | -11’581 | 4’554 |
| *Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement | ||
| Investissements en placements de capitaux | -153’531 | -212’707 |
| Désinvestissements en placements de capitaux | 173’435 | 205’448 |
| Investissements en immobilisations incorporelles | -234 | -499 |
| Désinvestissements en immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Investissements en immobilisations corporelles | -3’440 | -5’398 |
| Désinvestissements en immobilisations corporelles | 0 | 70 |
| Investissements en participations | 0 | -333 |
| Désinvestissements en participations | 45 | 0 |
| #Flux de trésorerie relatif aux opérations d’investissement | 16’274 | -13’417 |
| #Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement | ||
| Variation des dettes financières à court terme | 0 | 0 |
| Variation des dettes financières à long terme | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie relatif aux opérations de financement | 0 | 0 |
| #Somme des flux de trésorerie | 4’693 | -8’863 |
| *Variation de trésorerie | ||
| Trésorerie au 01.01 | 13’685 | 22’548 |
| Somme des flux de trésorerie | 4’693 | -8’863 |
| #Trésorerie au 31.12 | 18’378 | 13’685 |
Variation des capitaux propres
11| Chiffres en milliers de francs | Total bénéfices accumulés |
|---|---|
| #Capital propre au 01.01.2024 | 194’541 |
| Résultat net 2024 | 26’683 |
| *Capital propre au 31.12.2024 | 221’224 |
| Chiffres en milliers de francs | Total bénéfices accumulés |
|---|---|
| #Capital propre au 01.01.2023 | 218’656 |
| Résultat net 2023 | -24’115 |
| *Capital propre au 31.12.2023 | 194’541 |
Annexes
12- Glossaire
- Principes de présentation des comptes et d’évaluation
- Détails des comptes
- Annexe aux comptes
Fil rouge 2024
Passionnée de voyages et de nature, Séverine Amstutz est détentrice d’un diplôme artistique. Elle travaille comme graphiste, dans le domaine de la publicité. Depuis trois ans, elle réalise des illustrations de style néo-vintage, initialement de son village, puis du canton et, plus récemment, de toutes régions en Suisse. www.sa-illustrations.ch
